
Associer engrais verts et cultures potagères : une stratégie gagnante
Conseils et astuces pour un sol vivant et des récoltes rentables
Sommaire
Dans un potager, chaque parcelle de sol compte. Et les engrais verts peuvent y jouer un rôle essentiel. Bien plus que de simples couvre-sols, les engrais verts améliorent la fertilité et la structure du sol. En les associant intelligemment aux cultures potagères, il est possible de nourrir le sol en continu, et de créer un écosystème équilibré, productif et durable. Mais comment choisir les bonnes espèces ? À quel moment les semer ? Faut-il les semer entre deux cultures ou entre les rangs ?
Découvrez comment intégrer pleinement les engrais verts dans la gestion du potager, et associer stratégie culturale et observation du vivant pour tirer le meilleur parti de ces plantes précieuses.
À quoi servent les engrais verts ?
Les engrais verts sont de véritables alliés pour maintenir, voire améliorer, la fertilité et la vitalité du sol potager. En maîtrisant leur usage, on optimise la structure du sol, sa capacité à retenir l’eau, sa vie biologique, et même sa résistance aux maladies et aux adventices.
Les différentes fonctions des engrais verts
Grâce à leur système racinaire, les engrais verts ameublissent la terre, favorisent la circulation de l’air et de l’eau, et évitent le compactage du sol et la formation de la fameuse croûte de battance. Certaines espèces comme la moutarde blanche développent des racines pivotantes et puissantes capables de fissurer les sols tassés, ce qui profite aux cultures suivantes.
Ils agissent aussi comme des engrais naturels : en se décomposant, ils restituent au sol de la matière organique riche en éléments minéraux. Les fabacées (ex-légumineuses), par exemple, fixent l’azote atmosphérique grâce à leurs nodosités racinaires, enrichissant le sol de cet élément essentiel à la croissance des plantes potagères.
Autre fonction précieuse : la couverture du sol, qui limite l’érosion, freine l’évaporation de l’eau et empêche le développement des adventices. Semés après une récolte ou entre les cultures, les engrais verts créent un tapis végétal protecteur.
Quelques-unes d’entre elles offrent des floraisons très mellifères et nectarifères qui attirent les insectes pollinisateurs.
Enfin, certaines espèces ont un effet protecteur, en agissant sur les pathogènes ou les ravageurs. La moutarde, par exemple, libère des composés soufrés à l’effet biofumigant lorsqu’elle est enfouie verte, ce qui peut limiter les maladies du sol.

La phacélie est un engrais vert qui produit beaucoup de biomasse
Les différentes familles d’engrais verts
Le choix de l’engrais vert dépend largement des objectifs recherchés. Voici les grandes familles à connaître :
- Les Fabacées (ex-légumineuses) comme la vesce de printemps ou d’hiver, les trèfles blanc, violet ou incarnat, le sainfoin, le mélilot, la luzerne. Elles sont championnes de la fixation d’azote. Idéales avant des cultures gourmandes comme les solanacées (tomate, aubergine) ou les cucurbitacées.
- Les Poacées (graminées) comme le seigle, l’avoine, le ray-grass. Elles produisent une biomasse abondante, protègent le sol du lessivage hivernal et contribuent à le structurer. Leur décomposition lente apporte un humus stable.
- Les Brassicacées comme la moutarde. Leur enracinement vigoureux améliore la porosité du sol. Attention toutefois à ne pas les utiliser avant des cultures de la même famille pour éviter les maladies communes des brassicacées.
- La phacélie et le sarrasin (familles des Boraginacées et des Polygonacées ) : non apparentées aux légumes courants, ils sont parfaits dans une rotation. Ils offrent une floraison mellifère et un enracinement efficace, tout en étant faciles à détruire.
L’intérêt des mélanges d’engrais verts
Pour maximiser les bénéfices, les mélanges d’engrais verts ou mélanges améliorants sont de plus en plus utilisés. Une association vesce-avoine ou seigle, par exemple, combine fixation d’azote et structuration du sol. On peut aussi marier légumineuses, graminées et une plante mellifère pour couvrir un large spectre de besoins.
Lire aussi
Engrais verts : tout savoir !Comment associer les engrais verts au potager ?
L’intégration des engrais verts dans la rotation potagère n’est pas un simple ajout, c’est une stratégie culturale à part entière. En effet, les engrais verts sont des cultures à part entière, au même titre que les légumes. Cela implique de les intégrer dans la planification annuelle de votre potager.
Les engrais verts dans les rotations culturales
Dans une logique de rotation classique, les engrais verts peuvent être plantés avant une culture principale pour préparer et enrichir le sol. Ainsi, un semis de phacélie et de seigle à l’automne peut précéder les tomates plantées au printemps suivant, tout en protégeant le sol pendant l’hiver. De même, les fabacées apporteront de l’azote.
On peut aussi semer les engrais verts après une culture courte ou précoce, pour maintenir une couverture vivante. Après une récolte d’ail ou d’oignons en été, un engrais vert rapide comme la moutarde ou le sarrasin peut être implanté jusqu’à l’automne.
Enfin, les engrais verts se sèment simplement entre deux saisons, comme culture intermédiaire.

La moutarde blanche peut se semer après les oignons ou les ails
Les engrais verts comme cultures intercalaires
Une autre stratégie consiste à semer certains engrais verts en intercalaire, c’est-à-dire entre les rangs de cultures longues, comme les tomates, le maïs, ou les courges palissées. Ces engrais verts jouent un rôle de couvre-sol vivant, empêchant les adventices de s’installer. Leur système racinaire améliore la structure du sol sans concurrencer excessivement la culture principale et ils stimulent la vie biologique du sol en continu, tout en le maintenant actif.
Pour les cultures intercalaires, le jardinier doit privilégier le trèfle, ou la phacélie. Il faut en effet choisir des espèces à croissance modérée. Il faut en outre être attentif à la gestion de la lumière et des arrosages : les plantes intercalaires ne doivent pas faire trop d’ombre aux cultures potagères ou les priver d’eau.
Comment choisir le bon engrais vert selon la culture potagère ?
Associer l’engrais vert à la culture potagère suivante (ou précédente) n’est pas une affaire de hasard : il s’agit de tirer profit de leurs effets sans induire de concurrence, de carences ou de risques sanitaires. Pour chaque type de légume, certaines familles d’engrais verts sont à privilégier, d’autres à éviter.
- Avant les légumes gourmands, souvent de la famille des Solanacées, comme la tomate, l’aubergine, le poivron…il est recommandé de semer une association de deux engrais verts, le seigle et la vesce de printemps. Pour ces légumes dits gourmands, la vesce enrichit le sol en azote, l’avoine produit une biomasse équilibrée et améliore la structure
- Avant les Brassicacées comme les choux, les navets, les radis… il faut éviter de semer de la moutarde blanche qui peut favoriser le développement de pathogènes communs, tels que la hernie du chou. Il est préférable de mettre des graminées comme le seigle ou de la phacélie pour obtenir un effet structurant
- Avant les Fabacées potagères comme les haricots, les petits pois, les fèves, il est recommandé de semer des engrais verts non fixateurs d’azote comme la moutarde et l’avoine, qui n’épuiseront pas la vie microbienne
- Avant les cucurbitacées (courges, courgettes, concombres, melons…) Une culture hivernale de seigle ou un mélange de vesce et de phacélie permet de restituer une matière organique abondante et bien décomposée au moment du semis ou de la plantation. En effet, ces plantes potagères aiment les sols riches et ameublis
- Avant les légumes-feuilles à la croissance rapide tels que la salade, les épinards, la roquette, n’hésitez pas à semer un engrais vert à la croissance rapide (moutarde ou sarrasin) qui régénère le sol sans gêner la mise en place d’une culture courte.

La vesce de printemps est idéale, semée avant les légumes gourmands
Lire aussi
Engrais verts : pourquoi, comment ?Quand et comment semer et faucher les engrais verts ?
Pour tirer pleinement parti des engrais verts, il est essentiel de bien choisir le moment de semis et de maîtriser les techniques d’implantation et de destruction.
Un semis selon les saisons
Les engrais verts peuvent être semés à différentes périodes de l’année :
- Le semis de printemps (dès mars) est idéal pour combler les vides entre les premières plantations et les cultures estivales. On privilégiera des espèces à croissance rapide comme la moutarde ou la phacélie
- Le semis en été se fait après la récolte des légumes primeurs ou en attente de culture d’automne, les semis de sarrasin ou de trèfle incarnat sont intéressants pour une couverture estivale rapide
- Le semis d’automne (septembre-octobre) permet d‘installer des engrais verts d’hiver comme le seigle, la vesce d’hiver ou le lotier corniculé, un mélange vesce-avoine ou un mélange améliorant, qui protégeront le sol du froid, du ruissellement et de l’érosion
Le semis se fait en général à la volée, ou en ligne pour des cultures intercalaires. Il faut bien arroser après le semis, surtout en été.
L’idée est de ne jamais laisser le sol nu trop longtemps, car cela favorise le lessivage des nutriments, la croissance des adventices et la perte de structure.
La gestion et la destruction des engrais verts
La phase de destruction est tout aussi essentielle que le semis. Elle se fait suivant trois techniques :
- Par fauchage ou broyage : on intervient généralement avant la montée en graines pour éviter l’envahissement et pour que la matière soit plus facile à décomposer
- Par incorporation au sol : classique, mais pas toujours nécessaire. On peut enfouir légèrement les résidus broyés ou tondus ou les laisser en surface
- Par mulch de surface : c’est une alternative douce, qui consiste à laisser la biomasse en paillage, nourrissant ainsi les micro-organismes sans perturber le sol.
- Abonnez-vous
- Sommaire
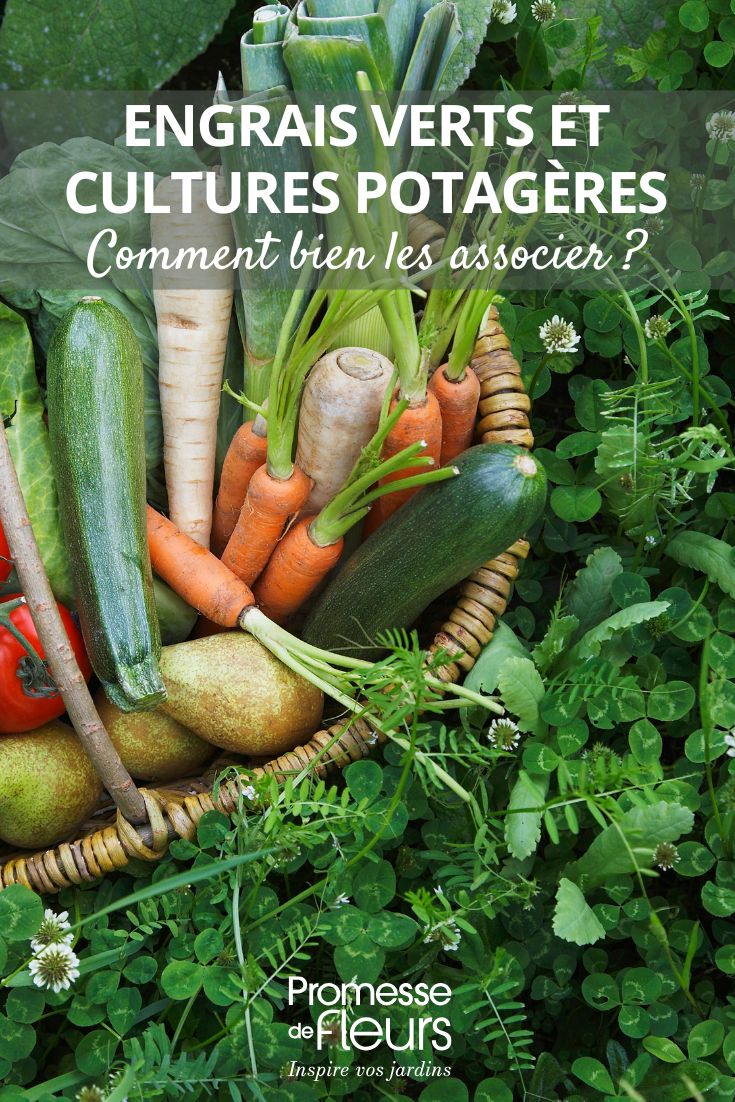































Commentaires