
Limaces au jardin : comprendre leur cycle de vie pour mieux les maîtriser
Tout savoir sur le comportement, la reproduction et la croissance des limaces
Sommaire
Chaque printemps, surtout s’il est pluvieux, les jardiniers doivent composer avec les limaces qui envahissent les potagers et les jardins d’ornement pour faire table rase des jeunes pousses. Alors, certes, si leur nombre est limité, le jardinier va accepter la présence de ces gastéropodes. En revanche, lorsque ces limaces transforment le potager en champ de bataille, la guerre est déclarée ! Or, pour mieux organiser la lutte contre ces mollusques au corps mou, peut-être est-il judicieux de comprendre leur développement, leur cycle de vie, leur biologie ?
Découvrez tout ce que vous devez savoir sur la vie des limaces, de la ponte des œufs à leur hivernation, pour anticiper leurs pics d’activité et mettre en œuvre des méthodes de régulation efficaces.
→ En plus de cet article, retrouvez aussi notre podcast sur “comment lutter contre les limaces” :
Quelles sont les différentes espèces de limaces du jardin ?
En arpentant régulièrement son jardin ou son potager, un jardinier s’aperçoit vite qu’il existe différentes limaces, plus ou moins grandes, plus ou moins colorées, plus ou moins voraces… En effet, derrière le nom vernaculaire de “limaces”, sont regroupées différentes espèces de gastéropodes terrestres, qui appartiennent à des familles différentes, parmi lesquelles on peut citer les Agriolimacidées, les Arionidés, les Milacidées, les Limacidées… Chaque famille est décomposée en différents genres, les plus répandues étant les limaces du genre Limax, Deroceras, Lehmania et Arion.
Dans nos jardins, les limaces les plus courantes sont :
- La limace grise (Deroceras reticulatum) : c’est la plus fréquente dans les jardins. Sa taille est variable entre 25 et 30 mm
- La limace rouge (Arion rufus) : c’est une limace de taille moyenne, d’environ 15 mm, dont la couleur varie du rouge foncé à l’orange et au noir. Elle a une prédilection pour les tubercules et les racines
- La limace des jardins (Arion hortensis) : c’est une limace également très courante, de couleur grise à noire. Elle mesure de 30 à 50 mm et aime se cacher sous les pierres, les feuilles mortes…
- La loche méridionale ou limace espagnole (Arion lusitanicus) : c’est une limace aux couleurs sombres, souvent brun foncé, qui tend à se développer
- La limace léopard (Limax maximus) : c’est une limace qui ne s’attaque pas aux plantes du jardin, mais plutôt aux déchets organiques, voire à d’autres limaces. Elle est très reconnaissable aux points qui ponctuent sa robe.

Dans le sens des aiguilles d’une montre, la limace grise, la limace léopard et la loche méridionale
Si chaque espèce possède ses propres préférences écologiques et ses particularités de développement, leur cycle de vie présente des constantes, notamment en lien avec l’humidité et les températures douces.
La plupart des limaces qui posent un problème au jardin sont hermaphrodites, c’est-à-dire qu’elles possèdent à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles. Cela leur permet de s’accoupler avec n’importe quel individu adulte, augmentant considérablement leur potentiel reproducteur. Et leur propagation !
Une activité liée aux conditions climatiques
Le rythme de vie des limaces est dicté par les conditions météorologiques. L’humidité est leur principal moteur. Sans mucus, elles ne peuvent ni se déplacer, ni se nourrir. Leur activité est donc maximale lors des nuits humides, après la pluie ou par temps couvert, surtout au printemps et à l’automne. À l’inverse, la chaleur sèche ou les grands froids limitent fortement leurs déplacements. Lors des étés chauds, elles entrent en estivation et se terrent profondément dans le sol ou sous les pierres. En hiver, elles ralentissent leur métabolisme ou hivernent, selon leur stade et leur espèce.
Il faut noter que ces périodes de dormance ne signifient pas l’absence totale de limaces, mais un ralentissement temporaire. Les œufs enfouis restent protégés et peuvent éclore dès que les conditions redeviennent favorables. Ainsi, une pluie d’avril ou de septembre peut provoquer une émergence massive en quelques jours.

Le rythme de vie des limaces est dicté par les conditions météorologiques
Quel est le cycle de vie des limaces ?
Le cycle de vie des limaces s’étend généralement sur une année complète. Tout commence par la ponte, qui se produit à plusieurs moments de l’année selon les conditions climatiques, en particulier en automne et au printemps. Les femelles pondent des œufs sphériques translucides, en petits amas de 10 à 50 unités, cachés dans des lieux frais et protégés : sous les planches, les pierres, les feuilles mortes ou dans les fentes du sol. Un seul individu peut produire entre 200 et 400 œufs par an, voire davantage chez les espèces les plus prolifiques comme les limaces du genre Arion.

Des œufs de limaces
L’éclosion intervient après 10 à 30 jours, selon la température et l’humidité. Les jeunes limaces, autonomes dès leur naissance sont déjà voraces. Pour autant, à ce stade juvénile, elles sont très sensibles à la sécheresse et aux prédateurs. Leur développement est progressif : elles muent, grossissent, et atteignent leur maturité sexuelle au bout de 2 à 5 mois.
Les adultes sont particulièrement actifs dans les périodes de forte humidité et de températures comprises entre 5 et 20 °C. Ils s’accouplent généralement la nuit ou au crépuscule. En automne, une seconde vague de ponte permet la survie hivernale de l’espèce. Les œufs pondus à cette période peuvent résister à des températures proches de 0 °C. Les adultes, quant à eux, cherchent des abris profonds ou meurent selon les conditions. Certaines espèces hivernent sous forme de juvéniles ou d’adultes en dormance.
Un cycle de vie qui rend leur régulation difficile
Leur biologie rend les limaces particulièrement résilientes. D’une part, leur capacité à pondre dans des abris inaccessibles complique leur détection. D’autre part, leur reproduction croisée ou autonome permet une recolonisation rapide, même à partir d’un petit nombre d’individus. En outre, leur mucus leur permet de se déplacer sur des surfaces sèches temporairement, de grimper sur les pots ou les tuteurs, et de franchir certains obstacles.
Leur mode de vie nocturne rend aussi leur présence difficile à repérer en journée. On devine leur activité par les traces de mucus brillantes sur les feuilles ou le sol, ou par les dégâts sur les jeunes plants : feuilles grignotées, tiges sectionnées, cotylédons entièrement mangés. C’est souvent au matin qu’on découvre les ravages, sans voir les coupables.
Enfin, leur développement discret dans le sol, surtout sous forme d’œufs ou de juvéniles, permet aux populations de persister malgré des interventions ponctuelles.
Comment agir efficacement contre les limaces ?
Plutôt que d’intervenir après les dégâts, un jardinier cherchera à anticiper les moments clés du cycle pour limiter la pression des limaces. Le printemps et l’automne étant des périodes critiques, il faut agir en conséquence :
- Entre mars et avril : au début du printemps, après les premières pluies, les œufs éclosent massivement. C’est à ce moment-là que les mesures préventives s’imposent. On peut dès lors installer et relever les planches, les tuiles et toutes les cachettes qui servent de refuges et donc de pièges.
- Entre mai et juin, l’activité des limaces ralentit avec la chaleur qui arrive. Pour autant, on continue l’inspection des massifs et bordures, ou des parcelles du potager.
- À la fin de l’été, en septembre, il faut absolument empêcher la ponte et perturber les cachettes dans lesquelles les œufs pourraient passer l’hiver. C’est pourquoi il faut absolument supprimer tous les éléments qui pourraient retenir l’humidité comme les pots, les tuiles, les feuilles mortes… et limiter la végétation trop dense.
- En hiver, un paillage grossier ou un griffage du sol permet d’exposer les œufs à la dessiccation ou aux prédateurs.

Juvéniles de limaces
Outre ces méthodes de prévention, il faut aussi adopter des moyens de lutte directe. Les œufs peuvent être détruits mécaniquement ou par exposition au gel. Les juvéniles sont sensibles aux pièges et barrières naturelles, au ferramol ou aux prédateurs naturels. Les adultes, plus résistants, peuvent être éliminés manuellement ou attirés par des appâts naturels.
Des auxiliaires à intégrer dans la stratégie de lutte contre les limaces
De nombreux prédateurs participent naturellement à la régulation des limaces. Hérissons, orvets, carabes, staphylins, crapauds et oiseaux insectivores consomment œufs, juvéniles et adultes. En favorisant leur présence au jardin par des zones refuges comme des tas de branchages ou de pierres, des haies, des abris ou des points d’eau, on introduit une régulation écologique complémentaire.
Il est aussi possible de recourir à une méthode biologique : les nématodes entomopathogènes (notamment Phasmarhabditis hermaphrodita) ciblent les limaces dans le sol, à condition que l’humidité soit suffisante. Ces vers microscopiques pénètrent dans le corps des limaces et provoquent leur mort en quelques jours. Ils sont particulièrement efficaces au printemps ou à l’automne, sur les jeunes limaces.
Pour en savoir plus :
- Abonnez-vous
- Sommaire
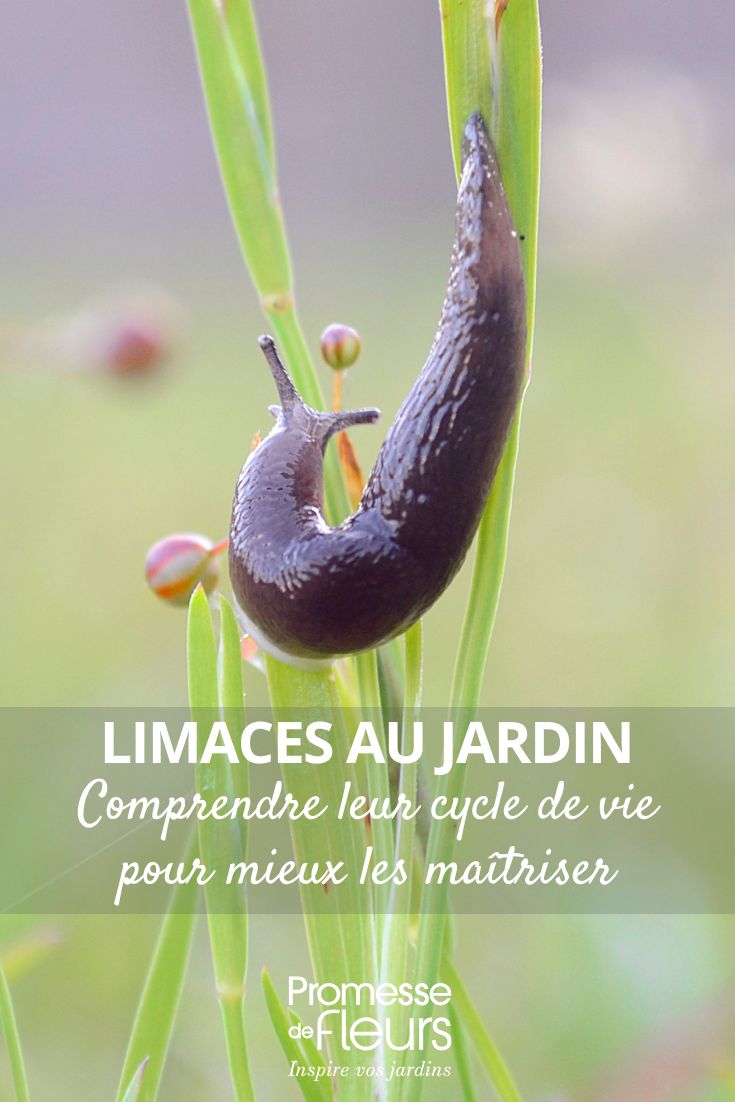































Commentaires