
Plantes aquatiques envahissantes : les identifier et limiter l’invasion
Des plantes à éviter ou à contrôler pour éviter l’impact négatif sur la biodiversité
Sommaire
Autour d’un bassin, d’une mare ou d’un étang, les plantes aquatiques sont incontournables. Elles assurent plusieurs rôles : oxygénation et filtration de l’eau, apport d’ombrage, abris et nourriture pour la faune sauvage, stabilisation des berges, mais aussi esthétisme bien sûr. Comme les autres plantes, elles seront choisies en fonction de vos conditions de culture (sol, exposition, climat…). Mais il est également important de prendre en compte leur capacité d’expansion. Certaines plantes aquatiques sont en effet considérées comme des espèces envahissantes ou invasives, à l’impact négatif sur le milieu. Voyons lesquelles et comment limiter leur prolifération.
Quel est l’impact des plantes aquatiques considérées comme envahissantes ?
Certaines plantes aquatiques sont désormais interdites à la vente. Elles font en effet partie des EEE (Espèces exotiques envahissantes). Cela signifie qu’elles ont été jugées trop perturbantes, voire destructrices, pour les zones humides. Ce sont des plantes qui ont été importées d’autres régions du monde et qui se sont naturalisées, modifiant ainsi la structure et le fonctionnement des écosystèmes naturels d’un lieu. Elles vont donc bouleverser l’équilibre en place et avoir un impact négatif sur la biodiversité indigène (naturellement présente dans le milieu). La présence de plantes envahissantes, aussi parfois appelées invasives, participe ainsi à la régression actuelle de notre biodiversité.
Ce sont bien souvent des plantes adaptables, capables de pousser dans diverses conditions de culture, même difficiles. De plus, elles ont généralement une capacité de reproduction très forte (par stolons, rhizomes, bouturage…). Elles vont donc concurrencer leurs homologues locaux, qui étaient adaptés à la faune du milieu et dont de nombreux animaux dépendaient. C’est ce qui peut créer un déséquilibre dans la chaîne alimentaire particulièrement néfaste. Sur une zone d’eau, ces plantes peuvent grandir de plusieurs mètres carrés en quelques semaines et finir par étouffer le milieu. La photosynthèse des autres végétaux deviendra alors compliquée, l’oxygène se fera plus rare et l’eau deviendra plus stagnante, ce qui nuira à l’écosystème.
Nuançons toutefois en rappelant que le sujet n’est pas si binaire qu’il semble l’être : par évolution et du fait du dérèglement climatique, les plantes sont amenées à migrer naturellement. Par exemple, les plantes méditerranéennes « remontent » petit à petit en se naturalisant, notamment du côté de l’Atlantique. Certaines espèces que nous considérons comme invasives à un moment donné pourront donc, à terme, finalement être vues comme des indigènes. De plus, une plante indigène peut aussi se montrer envahissante (liseron sur terre, myriophylle en épis dans l’eau).

Quand on parle d’invasion, le terme n’est pas usurpé… ici la jussie (Ludwigia grandiflora) dans un étang dans les Landes en 2003 (© Wikimedia Commons, Alain Dutartre-Irstea)
Des exemples de plantes aquatiques invasives
Beaucoup de plantes flottantes, qui ne sont donc pas enracinées, mais qui peuvent former de grands tapis recouvrant la surface de l’eau, font partie des plantes aquatiques envahissantes. Elles peuvent être officiellement classées comme des EEE ou « juste » connues pour leur forte capacité d’expansion.
Parmi les plantes aquatiques qui colonisent très rapidement les milieux et qui peuvent créer des déséquilibres, citons notamment :
- la jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) ;
- la myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) et les myriophylles en général ;
- la laitue d’eau (Pistia stratiotes) ;
- l’élodée du Canada, à l’autre nom évocateur de « peste d’eau »(Elodea canadensis) ;
- la vallisnérie (Vallisneria) ;
- le potamot (Potamogeton natans) ;
- la sagittaire à larges feuilles (Sagittaria latifolia) ;
- la renoncule flottante (Ranunculus fluitans) ;
- la scirpe des marais (Eleocharis palustri) ;
- la pesse d’eau (Hippuris vulgaris) ;
- l’hétéranthère (Heteranthera).

Dans le sens des aiguilles d’une montre : Jussie, myriophylle du Brésil, pesse d’eau, élodée du Canada (photo Pl@ntNet) et renoncule flottante
Si ces plantes sont reconnues comme des EEE, elles n’ont plus le droit d’être commercialisées sur le territoire. Mais la liste des plantes envahissantes ou invasives peut varier en fonction des lieux : parce qu’elle est avide de soleil et de chaleur, une plante aquatique peut donc être considérée comme invasive dans le sud de la France, mais pas dans les régions plus fraîches. L’idéal est donc de se renseigner en fonction du pays et de la région.
Comment limiter la prolifération de certaines plantes aquatiques ?
Évidemment, la première solution pour empêcher la prolifération de plantes aquatiques envahissantes est de ne pas les choisir. Si certaines sont de toute façon interdites à la vente, il est également important de ne pas pratiquer de prélèvement au hasard dans la nature, dans le but de végétaliser son bassin ou sa mare.
Si vous souhaitez tout de même cultiver des plantes qui ont la réputation d’avoir un fort développement, optez pour une culture en contenant. Comme les plantes cultivées en pot, les plantes aquatiques cultivées en petits paniers auront une croissance plus facilement contrôlable. Pour cela, il faut donc disposer de paniers adaptés, qui seront lestés à l’aide de pierres par exemple. Le substrat de culture choisi devra être assez lourd, afin de ne pas s’échapper du panier. Cette méthode permet aussi de mieux contrôler leur positionnement sur la pièce d’eau et de déplacer les plantes à rusticité limitée en hiver. Ce mode de culture convient aussi bien aux plantes immergées qu’aux plantes semi-immergées. Il est toutefois préférable de choisir cette solution uniquement si vous habitez à distance de zones naturelles et humides : certaines plantes aquatiques produisent des graines qui peuvent être disséminées spontanément par le vent et coloniser ainsi des espaces sensibles, même situées à plusieurs mètres de là.
Ensuite, il est important de contrôler les apports en nutriments, qui peuvent favoriser la croissance de plantes déjà vigoureuses. Tout d’abord, évitez les apports excessifs d’engrais à proximité de la mare, du bassin ou de l’étang. Pensez aussi à éliminer régulièrement les feuilles mortes et les débris végétaux qui peuvent s’accumuler dans le point d’eau et aux alentours. Limitez la population de poissons éventuels en fonction de l’espace disponible. Un bon équilibre au niveau de l’eau, qui dépend de plusieurs facteurs (lumière naturelle, température, présence d’organismes vivants…) permet aussi de mieux contrôler les excès de nutriments.
Si des plantes aquatiques envahissantes sont déjà trop présentes, il sera indispensable de réduire leur expansion en procédant à un arrachage manuel. Pour cela, utilisez par exemple un couteau aquatique afin d’élaguer les végétaux concernés. Retirez les déchets de taille à l’aide d’un râteau flottant ou d’une épuisette. Procédez avant la saison de floraison pour éviter la dissémination par les graines.
Pour certaines plantes, comme la scirpe des marais (Eleocharis palustris), il est également conseillé d’éliminer les fleurs pour éviter une dissémination importante.
Une autre solution, plus radicale, consiste à priver de lumière la plante concernée, en installant un voile d’ombrage empêchant la croissance et provoquant petit à petit le dépérissement. Il existe des solutions justement créées pour cette fonction, qui se présentent sous forme de toiles ou de filets tissés résistants aux UV. Inconvénients principaux : ils devront rester en place plusieurs mois pour être efficaces et ne sont pas très esthétiques.
Notons que nous vous déconseillons évidemment l’emploi de produits pesticides et chimiques, qui feraient plus de mal que de bien au milieu, en éliminant tous les végétaux sans distinction et en polluant l’eau, impactant ainsi toute la biodiversité.
- Abonnez-vous
- Sommaire
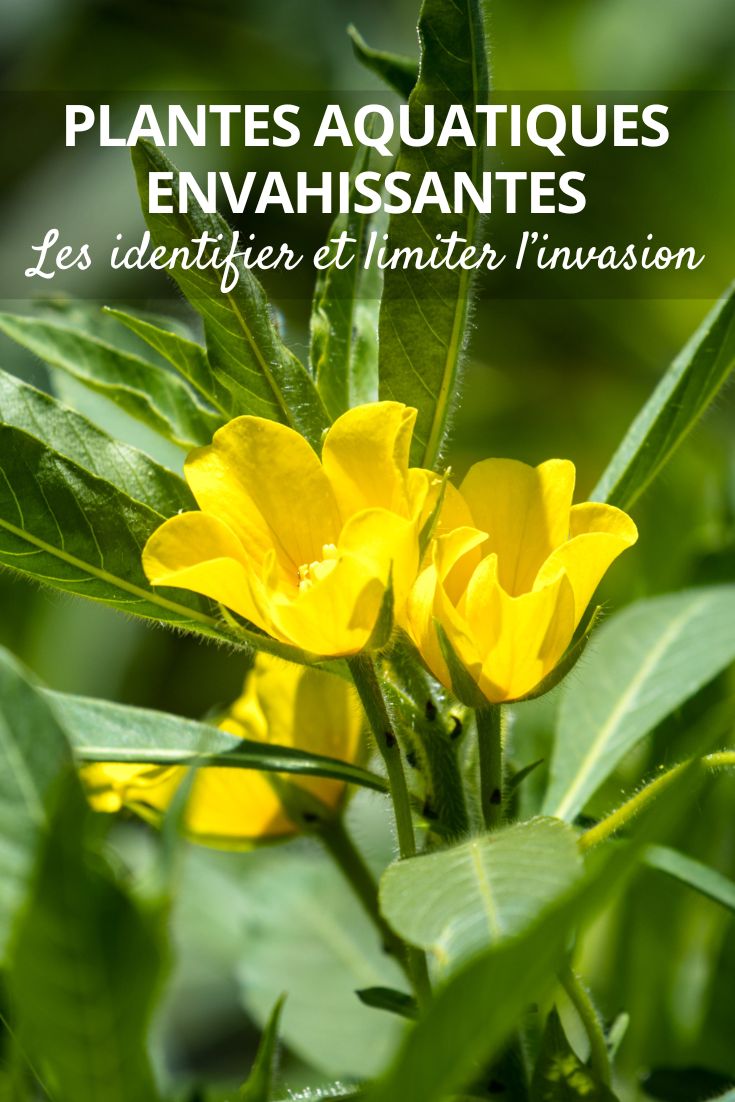































Commentaires